|
 Président Omar al-Bashir
Président Omar al-Bashir
Histoire
du Darfour
|
La crise du
Darfour est un conflit qui se déroule dans cette région
de l'ouest du Soudan. Les deux principaux protagonistes sont d'une
part l'armée soudanaise, et la milice janjaweed, recrutée
principalement parmi les tribus du nord, les Rizeigat, et d'autre
part plusieurs autres groupes rebelles, notamment le Mouvement de
Libération du Soudan et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité,
qui recrutent principalement dans les ethnies Fur, Zaghawa et Massaleit.
Le gouvernement soudanais, qui publiquement dénie tout soutien
au mouvement janjaweed, a fourni de l'argent et une assistance à
cette milice et a participé avec elle à des attaques
conjointes contre les tribus occupant les territoires sur lesquels
les rebelles du Darfour trouvent leurs soutiens. Le conflit a débuté
en février 2003. A la différence de la seconde guerre
civile soudanaise, qui a opposé les musulmans du nord aux chrétiens
et animistes du sud, presque tous les combattants et les victimes
du Darfour appartiennent à la première catégorie.
Les
attaques du gouvernement et des Janjaweed contre la population civile
non-Baggara ont provoqué une crise humanitaire majeure. Il y
a plusieurs évaluations du nombre de morts, qui tournent toutes
autour de plusieurs centaines de milliers. Les Nations Unies pensent
que l'on peut chiffrer à 450 000 les personnes tuées dans
les combats ou mortes de maladies. La plupart des ONG parlent de 200
000 à 400 000 victimes, en se basant sur les données de
la Coalition pour la Justice Internationale, qui ont depuis été
reprises par les Nations Unies.
Le gouvernement soudanais reconnaît quant à lui le chiffre
de 9 000 tués, on s'en doute très sous-estimé...
en octobre 2006, on montait à 2,5 millions le nombre de personnes
déplacées par la guerre. Le gouvernement soudanais a réussi
à contrôler l'information en emprisonnant ou en assassinant
les témoins depuis 2004 et en détruisant les preuves comme
ces dérangeantes fosses communes, oblitérant leur valeur
"légale". Par ailleurs, en obstruant et en arrêtant
les journalistes, le gouvernement soudanais a été capable
de dissimuler ce qui se passait réellement sur le terrain. Les
médias de masse ont à nouveau décrit ce conflit
comme un "nettoyage ethnique" et un"génocide"
et le font encore sans hésitation. Le gouvernement des Etats-Unis
lui-même l'a affirmé, bien que les Nations Unies l'aient
récusé. En mars 2007, la mission de l'ONU accuse le gouvernement
soudanais d'orchestrer et de prendre part à de "grandes
violations" au Darfour et appelle à une action internationale
de toute urgence pour protéger les civils sur place.
Après
des combats très durs en juillet et août 2006, le conseil
de sécurité des Nations Unies approuve, le 31 août
2006, la résolution 1706 qui prévoit le déploiement
d'une force de 17 300 casques bleus destinée à remplacer
la force mal payée et mal équipée de l'Union Africaine,
qui compte 7 000 hommes pour maintenir la paix au Soudan. Le Soudan
s'oppose fortement à ce projet et affirme que cette force serait
considérée comme une troupe d'occupation étrangère.
Le jour suivant, l'armée soudanaise lance une offensive de grande
ampleur dans la région. Dans le même temps, le conflit
devient part intégrante de la plus vaste guerre en Afrique Centrale.
Arrière-plan
Le
conflit au Darfour comporte beaucoup de causes qui s'entremêlent
à l'envie. Tandis que le Soudan est enraciné dans une
inégalité structurelle entre le centre du pays autour
du Nil et les zones "périphériques" comme le
Darfour, les tensions s'exacerbent dans les deux dernières décennies
du XXème siècle par la combinaison des calamités
environnementales, de l'opportunisme politique et des politiques régionales.
Un point de grande confusion a été la caractérisation
du conflit comme affrontement des populations noire et arabe, une dichotomie
qu'un historien a qualifié de "doublement vraie et fausse".
A la fin du XIVème siècle ou au début du XVème
siècle, la dynastie Keira des Fur, dans les montagnes Marrah,
établit un sultanat comportant l'islam comme religion d'Etat.
Ce sultanat est conquis par une force de turco-égyptiens qui
s'étendent vers le sud, le long du Nil, et qui est à son
tour défaite par Muhammad Ahmad, autoproclamé lui-même
Mahdi. L'Etat mahdiste s'effondre sous les coups de boutoir de la force
britannique menée par lord Herbert Kitchener, qui établit
un condominion anglo-égyptien pour diriger le Soudan. Les Britanniques
reconnaissent de jure l'autonomie du Darfour jusqu'en 1916, quand ils
envahissent la région et l'incorporent au pays. A l'intérieur
du Soudan anglo-égyptien, l'essentiel des ressources est consacré
à Khartoum et à la province du Nil Bleu, laissant le reste
du pays relativement sous-développé.
Les
habitants de la vallée du Nil, qui ont bénéficié
des investissements britanniques, poursuivent le schéma de marginalisation
économique et politique après l'indépendance du
pays, obtenue en 1956. Aux élections de 1968, les rivalités
de factions à l'intérieur du parti dirigeant Umma mènent
les candidats, notamment Sadiq-al-Mahdi, à essayer de détacher
des portions de l'électorat du Darfour, soit en blâmant
les Arabes pour le sous-développement de la région dans
le cas d'une politique attirant les peuples sédentaires, ou en
appelant les semi-nomades Baggara à soutenir leurs camarades
arabes du Nil. Cette dichotomie Arabes/Africains, qui n'est en aucune
façon une voie indigène de perception des relations locales,
se trouve exacerbée après que le président de la
Lybie, Khadafi, se soit focalisé sur l'établissement d'une
ceinture arabe par-delà le Sahel et ait proclamé une idéologie
de la suprématie arabe. Cela a pour résultat une séquence
d'interactions entre le Soudan, la Lybie et le Tchad entre la fin des
années 60 et les années 80, incluant la création
d'une Légion Islamique appuyée par la Lybie, tandis que
le président soudanais Gaafar Nimeiry établit le Darfour
comme base arrière d'une force rebelle menée par Hissène
Habré, qui tente de renverser le gouvernement du Tchad tout en
étant hostile à Kadhafi.
En
1983 et 1984, les pluies se font rares et le pays est plongé
dans la famine. On compte 95 000 morts au Darfour sur une population
estimée à 3,1 millions de personnes. Nimeyri tombe le
5 avril 1985, Sadiq-al-Mahdi revient d'exil, s'entend avec Khadafi pour
obtenir de l'argent afin de gagner les élections à venir
en échange de la cessation du Darfour à la Lybie, promesse
que le Soudanais n'honore pas.
Début
2003, deux groupes rebelles locaux, le Mouvement pour la Justice et
l'Egalité et le Mouvement de Libération du Soudan, accusent
le gouvernement d'oppression à l'égard des non-Arabes.
Le second, plus important que le premier, est généralement
associé avec les Fur et les Masalit, ainsi qu'avec le clan Wagi
des Zaghawa, alors que le premier groupe est formé à partir
du clan Kobe des Zaghawa. Plus tard la même année, des
leaders des deux bandes, le gouvernement soudanais et les représentants
de la communauté diplomatique internationale sont rassemblés
à Genève par le Centre pour le Dialogue Humanitaire pour
trouver des solutions à la crise. En 2004, le Mouvement pour
la Justice et l'Egalité rejoint le Front Oriental, un groupe
formé d'une alliance entre deux groupes rebelles tribaux de l'est,
les Lions Libres de la tribu Rashaida et le Congrès de Beja.
On accuse ce même mouvement d'être en fait contrôlé
par Hassan al-Turabi.
Le 20 janvier 2006, le Mouvement de Libération du Soudan annonce
une fusion avec le Mouvement pour la Justice et l'Egalité pour
créer une Alliance des Forces Révolutionnaires de l'Ouest
du Soudan. Pourtant, en mai de la même année, les deux
groupes négocient encore comme des entités séparées.
Hassan al-Turabi

Histoire du conflit 2003-2007
Le point initial du début du conflit dans la région du
Darfour est reconnu comme étant le 26 février 2003, quand
un groupe se baptisant lui-même Front de Libération du
Darfour revendique publiquement une attaque contre Golo, le quartier
général du district de Jebel Marra. Même avant cette
attaque, pourtant, le conflit était déjà en marche
au Darfour, les rebelles ayant assailli des stations de police, des
avant-postes et des convois militaires, et le gouvernement avait engagé
en réponse un assaut massif sur la place forte rebelle des montagnes
Marrah. La première action militaire des rebelles est l'attaque
victorieuse d'une garnison de l'armée dans les montagnes, le
25 février 2002, et le gouvernement soudanais est quant à
lui conscient d'un mouvement rebelle unifié depuis l'attaque
de la station de police de Golo en juin 2002. Les chroniqueurs Julie
Flint et Alex de Waal affirment que le début de la rébellion
peut être mieux datée au 21 juillet 2001, quand un groupe
de Fur et de Zaghawa se rencontre à Abu Gamra et jure sur le
Coran de travailler ensemble pour lutter contre les attaques promues
par le gouvernement sur leurs villages. On doit noter que presque tous
les habitants du Darfour sont musulmans, tout comme les Janjaweed et
les chefs du gouvernement de Khartoum.
Minni Minnawi,
l'un des chefs de l'Armée de Libération du Soudan

Le 25 mars, les rebelles s'emparent de la garnison de Tine sur la frontière
avec le Tchad, capturant des quantités d'armes et de vivres.
En dépit de menaces du président Omar-al-Bashir de "lâcher"
l'armée, les militaires ont peu de moyens à leur disposition.
Les troupes sont à la fois déployées au sud, où
la seconde guerre civile soudanaise touche à sa fin, et à
l'est, où des groupes rebelles appuyés par l'Erythrée
menacent le nouveau pipeline construit pour les champs de pétrole
du centre du pays et qui va jusqu'à Port Soudan. La tactique
hit-and-run des rebelles met à l'oeuvre des Toyota Land Cruisers,
traversant rapidement les régions semi-désertiques, déroutant
l'armée, pas du tout entraînée à ce genre
d'opérations éclairs en milieu difficile. Pourtant, ses
bombardements aériens des positions rebelles dans les montagnes
sont dévastateurs.
A
5h30 le 25 avril 2003, une force combinée de l'Armée de
Libération du Soudan et du Mouvement pour la Justice et pour
l'Egalité montée sur 33 Land Cruisers attaque la garnison
endormie de al-Fashir. En 4h, 4 bombardiers Antonov et hélicoptères
de combat (d'après le gouvernement, 7 selon les rebelles) sont
détruits au sol, 75 pilotes, techniciens et soldats sont tués
et 32 sont capturés dont le commandant de la base, un Major General.
Le succès de ce raid est sans précédent au Soudan
: en 20 ans de guerre civile dans le sud, l'Armée de Libération
du Peuple du Soudan, un autre groupe rebelle, n'a jamais réussi
une telle opération.
Le déferlement des Janjaweed (2003)
Le raid sur al-Fashir est un moment capital militairement et psychologiquement
parlant. L'armée a été humiliée et le gouvernement
doit faire face à une difficile situation stratégique.
L'armée a clairement besoin d'être réentraînée
et redéployée face à ce nouveau type d'opérations
et il y a des appréhensions fondées sur la loyauté
des nombreux sous-officiers et soldats du rang originaires du Darfour
et présents dans les forces armées. La responsabilité
de mener le conflit est confiée au renseignement militaire soudanais.
Pourtant, à la mi-2003, les rebelles ont eu l'avantage dans 34
engagements sur 38 ! . En mai, l'Armée de Libération du
Soudan détruit un bataillon à Kutum, tuant 500 hommes
et en capturant 300, et à la mi-juillet 250 soldats supplémentaires
sont tués lors d'un raid sur Tine. L'Armée de Libération
du Soudan commence à s'étendre plus loin à l'est,
menaçant d'étendre le conflit au Kordofan.
Pourtant, à ce moment-là, le gouvernement va changer de
stratégie. Etant donné que l'armée a été
lourdement battue, l'effort de guerre repose sur trois éléments
: le renseignement militaire, la force aérienne et les Janjaweed,
des éleveurs de troupeaux Baggara armés dont le gouvernement
a commencé à se servir pour réprimer l'insurrection
Masalit entre 1996 et 1999. Les Janjaweed sont placés au centre
de la nouvelle stratégie de contre-insurrection. Les ressources
militaires sont concentrées sur le Darfour et les Janjaweed sont
constitués en force paramilitaire, avec un équipement
en communications complet et même quelques pièces d'artillerie.
Les résultats probables d'une telle stratégie sont clairs
aux yeux des planificateurs militaires : des schémas similaires
ont été employés dans les montagnes Nuba et près
des champs pétrolifères du sud pendant la décennie
précédente et ont provoqué des violations massives
des droits de l'homme et des déplacements forcés de populations.
Les Janjaweed, mieux armés, prennent rapidement le dessus. Au
printemps 2004, plusieurs milliers de personnes -majoritairement de
la population non-arabe- ont été tuées et plus
d'un million chassées de chez elles, causant une crise humanitaire
majeure dans la région. La crise prend une dimension internationale
quand plus de 100 000 de ces réfugiés se déversent
dans le Tchad voisin, poursuivis par les miliciens janjaweed qui se
heurtent aux troupes tchadiennes le long de la frontière. En
avril, ce sont plus de 70 miliciens et 10 soldats tchadiens qui périssent
en un seul affrontement. Un observateur des Nations Unies rapporte que
les villages non-arabes sont ravagés alors que c'est l'inverse
pour leurs homologues arabes.
Un milicien
janjaweed monté

En 2004, le Tchad ouvre les négociations à N'Djamena,
menant le 8 avril à un accord de cessez-le-feu humanitaire entre
le gouvernement soudanais, le Mouvement pour la Justice et l'Egalité
et le Mouvement de Libération du Soudan. Un groupe se sépare
du Mouvement pour la Justice et l'Egalité en avril -le Mouvement
National pour la Réforme et le Développement- et ne participe
pas aux négociations de cessez-le-feu et à l'accord. Les
attaques des Janjaweed et des rebelles continuent pendant les pourparlers.
L'Union Africaine forme une commission de cessez-le-feu pour contrôler
l'application de ce dernier.
L'échelle de la crise sonne comme un avertissement à un
désastre imminent, et le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, prévient que le risque de génocide
est terriblement d'actualité au Darfour. La campagne janjaweed
mène à des comparaisons avec le génocide rwandais,
un parallèle contesté avec virulence par le gouvernement
soudanais. Les observateurs indépendants notent que les tactiques,
incluant le démembrement et la tuerie des non-combattants, y
compris les jeunes enfants et les bébés, relèvent
plus du nettoyage ethnique tel qu'on l'a connu en ex-Yougoslavie, mais
avertissent que l'éloignement de la région signifie que
des centaines de milliers de personnes sont coupées de toute
aide. Le groupe de crise international basé à Bruxelles
rapporte en mai 2004 que près de 350 000 personnes pourraient
mourir de privations ou de maladies.
Miliciens
janjaweed

Le
10 juillet 2005, l'ex-leader de l'Armée de Libération
Populaire du Soudan, John Garang, devient vice-président du Soudan.
Mais le 30 juillet, il meurt brutalement dans un accident d'hélicoptère.
Sa mort a des répercussions sur le long terme, et malgré
une sécurité plus assurée, les négociations
entre les différentes factions rebelles du Darfour piétinent.
Une
attaque sur la ville tchadienne d'Adre près de la frontière
soudanaise provoque la mort de 300 rebelles en décembre 2005.
Le Soudan est accusé de l'avoir fomentée : c'est la seconde
de ce genre en trois jours. Les tensions montantes dans le secteur poussent
le gouvernement du Tchad à déclarer son hostilité
à l'égard du Soudan et à appeler les citoyens du
pays à se mobiliser ensemble contre "l'ennemi commun".
L'accord de mai 2006
Le
5 mai 2006, le gouvernement du Soudan signe un accord avec la faction
de l'Armée de Libération du Soudan menée par Minni
Minawi. Mais cet accord est rejeté par deux autres groupes plus
restreints, le Mouvement pour la Justice et l'Egalité et une
faction rivale de l'Armée de Libération du Soudan. L'accord
a été orchestré par l'adjoint au secrétaire
d'Etat américain Robert B. Zoellick, Salim Ahmed Salim (au nom
de l'Union Africaine), des représentants de l'Union Africaine
et d'autres négociateurs étrangers opérant à
Abuja, au Nigéria. Cet accord appelle à un désarmement
de la milice janjaweed, au démantèlement des forces rebelles
et à leur incorporation dans l'armée.
Combattant
rebelle du Darfour

Juillet-août 2006
Pendant les mois de juillet et août 2006, les combats reprennent,
menaçant d'interrompre la plus vaste opération d'aide
humanitaire dans le monde, selon les termes des ONG forcées de
battre en retraite après des attaques contre leurs personnels.
Le Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan
propose l'envoi d'une force de 18 000 casques bleus dans la région
pour remplacer les 7 000 soldats de l'Union Africaine. En juillet, dans
la ville du Darfour de Kalma, 7 femmes, qui sortaient d'un camp de réfugiés
pour aller chercher du bois, sont attaquées, violées,
battues et dépouillées par les Janjaweed. Une fois leur
sinistre besogne achevée, ceux-ci les attachent nues et se moquent
d'elles avant de s'enfuir.
Le 18 août, l'adjoint au chef des forces de maintien de la paix
de l'ONU, l'assistant du Secrétaire Général pour
les opérations de maintien de la paix Hedi Annabi, avertit durant
une rencontre privée que le Soudan est train d'effectuer des
préparatifs pour une grande offensive militaire à venir
dans la région. Cet avertissement arrive un jour après
la déclaration de l'enquêteur spécial de la commission
de l'ONU pour les droits de l'homme, Sima Samar, qui faisait état
du peu d'effort du Soudan dans ce domaine en dépit de l'accord
de mai. Le 19 août, le Soudan réitère son refus
de voir remplacée la force de l'Union Africaine par 17 000 casques
bleus, en réponse à une déclaration des Etats-Unis
de "menace" à l'encontre du Soudan sur les "conséquences
possibles" de cette position.
Le 24 août, le Soudan rejette une rencontre prévue avec
le Conseil de Sécurité de l'ONU afin d'expliquer l'envoi
de 10 000 soldats soudanais au Darfour à la place du contingent
des 20 000 casques bleus proposés précédemment.
Le Conseil de Sécurité affirme qu'il tiendra la réunion
en dépit du refus soudanais. Le même jour, l'International
Rescue Committee rapporte que des centaines de femmes sont violées
et agressées sexuellement autour du camp de réfugiés
de Kalma, pendant les dernières semaines. Les Janjaweed utilisent
les viols comme arme de guerre. Culturellement parlant, dans la région,
les femmes violées sont considérées comme impures
et sont ostracisées. Les femmes sont donc souvent violées
en plein air, voire sur des places publiques, afin d'accroître
l'humiliation pour elles-mêmes et leurs familles. L'étendue
de cette pratique est probablement beaucoup plus grande que les renseignements
ne le laissent penser, car les femmes violées sont bien sûr
réticentes à se manifester. Le 25 août, le chef
du Bureau du Département d'Etat aux Affaires Africaines américain,
le secrétaire assistant Jendayi Frazer, avertit que la région
est menacée d'une crise grave à moins que la force de
casque bleus soit autorisée à se déployer. Le 26
août, deux jours avant la réunion du Conseil de Sécurité,
et le jour où Frazer doit arriver à Khartoum, Paul Salopek,
un journaliste américain du National Geographic Magazine, passe
devant un tribunal au Darfour étant accusé d'espionnage
; il a voyage illégalement dans le pays à partir du Tchad,
en raison des mesures sévères interdisant la présence
de journalistes étrangers. Il est plus tard relâché
après une négociation directe avec le président
al-Bashir. Cela intervient deux mois après que Tomo Kriznar,
un envoyé présidentiel de la Slovénie, ait été
condamné à deux ans de prison pour espionnage.
L'ONU propose une nouvelle force d'interposition
Le 31 août 2006, le Conseil de Sécurité approuve
une résolution afin d'envoyer une nouvelle force de 17 300 casques
bleus au Darfour. Le Soudan exprime une forte réticence face
à cette proposition. Le 1er septembre, les officiels de l'Union
Africaine rapportent que le Soudan a lancé une offensive de grande
ampleur au Darfour. Selon leurs dires, 20 personnes auraient trouvé
la mort et plus de 1 000 auraient été déplacées
dans les combats qui ont commencé plus tôt la même
semaine. Le 1er septembre, le Soudan demande à la force de l'Union
Africaine de quitter le secteur avant la fin du mois, ajoutant qu'ils
"n'ont aucun droit à transférer leur mission à
l'ONU ou à une autre force. Les droits sont aux mains du gouvernement
soudanais.". Le 4 septembre, dans un mouvement qui ne cause aucune
surprise, le président tchadien Idriss Déby appuie l'envoie
d'une force de casques bleus. L'Union Africaine, dont le mandat expire
le 30 septembre, confirme qu'elle se retirera à cette date. Le
jour suivant, pourtant, un haut officiel du département d'Etat
américain, qui conserve l'anonymat, affirme à des reporters
que la force africaine restera sur place après la fin officielle
du mandat, qualifiant cette possibilité "d'option viable".
Echec de l'exécution (septembre 2006)
Le 8 septembre 2006, le chef du Haut Commissariat aux Réfugiés
de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que le Darfour fait face "à
une crise humanitaire". Le 12 septembre, l'envoyé de l'Union
Européenne au Soudan, Pekka Haavisto, rapporte que l'armée
soudanaise "bombarde les civils au Darfour". Un officiel du
Programme alimentaire mondial prétend que l'approvisionnement
en nourriture a été interrompu pour au moins 355 000 personnes.
Le Secrétaire Général de l'ONU Kofi Annan dit au
Conseil de Sécurité que "la tragédie au Darfour
a atteint un moment critique. Elle mérite l'attention la plus
sérieuse du conseil et une action immédiate." . Le
14 septembre, le leader du désormais défunt Mouvement
de Libération du Soudan, alors assistant supérieur du
Président de la République et Président de l'autorité
régionale d'intérim du Darfour, Minni Minawi, révèle
qu'il n'est pas opposé au déploiement d'une force de casques
bleus, rompant ainsi la ligne du gouvernement soudanais qui considère
cette démarche comme une ingérence occidentale dans ses
affaires. Minawi renchérit en affirmant que la force de l'Union
Africaine "ne peut rien en raison de son mandat limité".
Khartoum, pourtant, reste fermement opposé à la solution
des casques bleus, que le président al-Bashir décrit comme
un plan colonial, ajoutant qu'il ne veut pas "que le Soudan devienne
un autre Irak".
Détérioration (octobre-novembre 2006)
Le 2 octobre, le plan de l'ONU étant suspendu en raison de l'opposition
du Soudan, l'Union Africaine annonce qu'elle va étendre sa présence
sur place jusqu'au 31 décembre 2006. 200 casques bleus sont tout
de même envoyés pour renforcer le contingent de l'Union
Africaine. Le 6 octobre, le Conseil de Sécurité vote pour
allonger le mandat de la mission de l'ONU au Soudan jusqu'au 30 avril
2007. Le 9 octobre, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture
place le Darfour en tête de liste des priorités alimentaires
sur près de 40 pays contenus dans ce rapport. Le 10 octobre,
le Haut Commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Louise Arbour,
affirme que le gouvernement soudanais avait connaissance d'attaques
menées par les Janjaweed au sud du Darfour, à Buram, le
mois précédent, une attaque qui a vu la mort de centaines
de civils.
Le
12 octobre, le ministre des Affaires Etrangères du Nigéria
Joy Ogwu arrive au Darfour pour une visite de 2 jours.
Il presse le gouvernement soudanais d'accepter le mandat de l'ONU. S'exprimant
en Ethiopie, le président du Nigéria Olusegun Obasanjo
s'exprime contre "le maintien et la vue sous nos yeux du génocide
au Darfour". Le 13 octobre, le président américain
Georges W. Bush impose des sanctions supplémentaires à
ceux qu'il estime complices des massacres dans le Darfur Peace and Accountability
Act of 2006. Ces mesures renforcent en fait celles déjà
existantes en prohibant tout commerce entre des citoyens américains
et le Soudan au sujet du pétrole (bien que les compagnies américaines
en aient reçu l'interdiction dès 1997), gelant les avoirs
des personnes fraudeuses et leur refusant l'entrée en territoire
américain. La mission de l'Union Africaine étant mal équipée
et sous-payée, la situation empire jusqu'au 31 décembre,
le gouvernement et ses milices ainsi que les rebelles violant le cessez-le-feu.
Des travailleurs d'ONG soulignent qu'ils ne peuvent accéder aux
zones critiques, avertissant que l'on risque de reconnaître la
situation de 2003-2004 au moment où les officiels de l'ONU annonçaient
au monde une crise humanitaire au Darfour. Le 22 octobre, le gouvernement
soudanais ordonne à l'envoyé de l'ONU Jan Pronk de quitter
le pays sous 3 jours. Pronk, l'officiel le plus titré présent
dans le pays, a été sévèrement critiqué
par l'armée après avoir mis en ligne sur son blog des
billets évoquant des défaites militaires de celle-ci au
Darfour. Le 1er novembre, le gouvernement américain annonce qu'il
va proposer un plan international, en espérant que le Soudan
le trouvera à son goût... Le 9 novembre, le haut conseiller
au président soudanais Nafie Ali Nafie annonce aux reporters
que le gouvernement va entamer des négociations sans conditions
avec le Front National de Rédemption -l'alliance rebelle du Darfour-
mais offre peu de certitudes sur l'espoir d'un accord. Le Front, qui
a rejeté l'accord de mai (sauf une fraction dissidente du Mouvement
de Libération du Soudan), ne fait pas de commentaires. Il a déjà
cherché auparavant un autre accord. Fin 2006, les Arabes du Darfour
montent leur propre mouvement rebelle, les Troupes des Forces Populaires,
et annoncent le 6 décembre qu'elles ont repoussé un assaut
de l'armée à Kas-Zallingi le jour précédent.
Dans une autre annonce, ils qualifient les Janjaweed de mercenaires
qui ne représentent pas le peuple arabe. Depuis 2003, de nombreux
groupes arabes ont manifesté leur opposition à la guerre
menée par le gouvernement au Darfour, certains signant même
des accords politiques avec les rebelles.
Le village
de Um Zeifa incendié par les milices janjaweed
Le compromis proposé d'une force de l'ONU et l'offensive soudanaise
Le
17 novembre, des rumeurs font état d'un accord potentiel pour
disposer "une force de maintien de la paix de compromis" au
Darfour, mais la solution est en fait rejetée par le Soudan.
L'ONU, pourtant, affirme le 18 novembre que le Soudan a accepté
le déploiement de cette force. Le Ministre des Affaires Etrangères
soudanais Lam Akol affirme "qu'il ne doit pas y avoir de discussions
autour d'une force mixte" et que le rôle de l'ONU doit se
cantonner dans un support technique. Le 18 novembre également,
l'Union Africaine annonce que l'armée soudanaise et les milices
qu'elles soudoient ont lancé une opération aéro-terrestre
de grande ampleur dans la région qui a déjà tué
70 civils. L'Union Africaine parle d'une "violation délibérée
des accords de sécurité". Le 25 novembre, un porte-parole
du Haut Commissaire de l'ONU pour les Droits de l'Homme accuse le gouvernement
soudanais "d'avoir provoqué une attaque délibérée"
contre les civils de la ville de Sirba le 11 novembre, tuant au moins
30 personnes. Le délégué du Commissariat prétend
que "contrairement aux dires du gouvernement, il apparaît
que les forces armées ont lancé une offensive d'ampleur
sur la cité et les propriétés des habitants, qui
implique aussi une destruction et un pillage effrénés
des biens de ces derniers".
Janvier-avril 2007 : accord de cessez-le-feu et sa rapide dissolution
En
accord avec la coalition Sauvez le Darfour, le gouverneur du Nouveau-Mexique
Bill Richardson et le président al-Bashir conviennent d'un cessez-le-feu
dans lequel "le gouvernement soudanais et les groupes rebelles
cessent les hostilités pendant 60 jours durant lesquels ils essayent
de parvenir à une paix durable. Par ailleurs, la presse appuyant
Sauvez le Darfour annonce que l'accord contient "un certain nombre
de concessions pour améliorer l'aide humanitaire et l'accès
des médias dans le Darfour". En dépit de cette formalité
accomplie du cessez-le-feu, d'autres tueries sont signalées par
les médias ainsi que d'autres violences. Le dimanche 15 avril
2007, des soldats de l'Union Africaine sont pris pour cible et certains
abattus. Le New York Times écrit qu'un rapport confidentiel de
l'ONU affirme que le Soudan achemine des armes et de l'équipement
lourd au Darfour en violation de la résolution du Conseil de
Sécurité et repeint ses avions militaires aux couleurs
de l'Union Africaine ou de l'ONU. La violence s'étend aussi au
Tchad voisin, dans la zone frontalière. Le 31 mars 2007, des
miliciens Janjaweed tuent 400 personnes dans la région frontalière
de l'ouest du Tchad. L'attaque a lieu sur les villages de Tiero et Marena.
Ils sont encerclés et criblés de balles. Les villageois
en fuite sont pourchassés. Les femmes sont enlevées et
les hommes abattus selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés
de l'ONU. Beaucoup des survivants meurent de privations ou de déshydratation
dans leur fuite. Le 14 avril, d'autres attaques ont lieu dans les mêmes
villages. Le 18 avril, le président Bush donne un discours au
mémorial américain de l'Holocauste dans lequel il critique
le gouvernement soudanais et menace de futures sanctions si la situation
ne s'améliore pas. Ces sanctions comprennent des restrictions
commerciales et monétaires avec le gouvernement soudanais ainsi
que 29 entreprises du pays.
Les charges du Tribunal Pénal International
Le
ministre des affaires humanitaires du Soudan, Ahmed Haroun, et un chef
de milice janjaweed, connu sous le nom d'Ali Kushayb, ont été
condamnés par le Tribunal Pénal International pour 51
faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ahmed
Haroun rétorque "qu'il ne se sent pas coupable", que
sa conscience est sans tâche, et qu'il est prêt à
assurer lui-même sa défense.
Mai 2007
Le président soudanais Omar al-Bashir et le président
tchadien Idriss Deby signe un accord de paix le 3 mai 2007 visant à
réduire la tension entre les deux pays. L'accord a été
soutenu par l'Arabie Saoudite. Il cherche à garantir que chaque
pays ne sera pas utilisé pour héberger, entraîner
et fonder des mouvements armés opposés à son voisin.
Le service des nouvelles de Reuters rapporte que "les craintes
de Deby quant à l'UFDD de Nouri qui a peut-être été
soutenue par l'Arabie Saoudite et le Soudan l'ont poussé à
conclure le pacte avec al-Bashir jeudi à travers la médiation
saoudienne". Colin Thomas-Jensen, un expert sur le Tchad et le
Darfour qui travaille avec le think-tank Groupe de Crise Internationale
a montré des doutes si "ce nouvel accord mènera à
un véritable dégel dans les relations ou une amélioration
quant aux conditions de sécurité". Par ailleurs,
l'Union des Forces de la Démocratie et du Développement
(UFDD), un mouvement rebelle tchadien, qui a mené une campagne
de guérilla contre le président Deby dans l'est du Tchad
depuis 2006, affirme que l'accord négocié avec les Saoudiens
n'arrêtera pas sa campagne militaire.
C'est seulement la politique de la carotte et du bâton que mènent
les Saoudiens avec l'UFDD qui a poussé Deby à la table
des négociations. Ainsi l'accord se fait au détriment
total des rebelles soudanais, laissant au gouvernement de Khartoum les
mains libres. C'est pendant le mois de mai que le site Google Earth
incorpore les localisations de conflit au Darfour.
A-5 Fantan
de construction chinoise à Nyala, mars 2007
La politique de sape des sanctions par la Russie et la Chine
Amnesty International produit un rapport accusant la Chine et la Russie
de fournir des armes, de l'équipement militaire et l'assistance
technique nécessaire. Ce matériel a été
convoyé au Darfour pour être utilisé par l'armée
et les Janjaweed, violant ainsi l'embargo de l'ONU sur les armes à
destination du Soudan. Dans le rapport, on trouve des photos de jets
chinois Fantan à Nyala, au Darfour, ainsi que celle d'un Antonov
26 peint en blanc. Le rapport prouve aussi que l'armée soudanaise
a mené une politique de bombardement sans restrictions des villages
civils au Darfour et dans l'est du Tchad en employant des avions d'attaque
au sol et des Antonov. Le rapport recèle aussi un cliché
d'un Mi-24 Hind, hélicoptère d'attaque russe (reg. n°928),
stationné à Nyala en mars 2007. La Sudan Air Force a employé
ce type d'appareil depuis plusieurs années en soutien des attaques
des miliciens janjaweed sur les villages du Darfour. Le rapport montre
aussi comment les Soudanais camouflent leurs appareils en les repeignant
en blanc pour prétendre qu'il s'agit d'avions civils, et neutres.
L'Antonov An-26 a été ainsi utilisé pour des missions
de bombardement.
La Chine et la Russe dénient avoir rompu les sanctions de l'ONU.
La Chine a des liens étroits, pourtant, avec le Soudan, et a
renforcé sa coopération militaire avec le pays début
2007. En raison des riches ressources pétrolières du Soudan,
la Chine considère ce partenariat comme stratégique pour
alimenter sa croissance économique en plein boom. La Chine a
aussi des intérêts commerciaux directs dans le pétrole
soudanais. La compagnie d'Etat CNPC contrôle 60 à 70% de
la production de pétrole du pays. Par ailleurs, la Chine possède
la plus grande part du capital de la compagnie nationale soudanaise
du pétrole (40 %), la Greater Nile Petroleum Operating Company.
La Chine s'est souvent opposée avec conviction aux sanctions
économiques et non-militaires à l'encontre du Soudan.
Un Mi-24
Hind au-dessus du Darfour

Juin
2007
Oxfam, une fédération d'organisations internationales,
annonce le 17 juin qu'elle abandonne Gereida, le plus grand camp du
Darfour, où plus de 130 000 personnes ont trouvé refuge.
L'agence met en avant l'inaction des autorités locales du Mouvement
de Libération du Soudan, qui contrôle la région,
et qui est incapable de protéger les travailleurs internationaux.
Un employé de l'ONG Action by Churches Together est assassiné
en juin dans l'ouest du Darfour.
Les attaques à mains armées contre les véhicules
des Nations Unies et des autres organisations sont fréquentes
-ce qui fait réfléchier ces dernières à
deux fois avant de rester dans la région.
Juillet 2007
BBC
News annonce qu'un énorme lac souterrain a été
découvert dans la région du Darfour. On pense que cette
découverte pourrait mettre fin à la guerre en éliminant
la compétition existante pour le contrôle des ressources
en eau. La France et le Royaume-Uni annoncent qu'elles vont faire pression
pour une résolution de l'ONU prévoyant une force de casques
bleus et de troupes de l'Union Africaine, ainsi que pour un cessez-le-feu
immédiat ; elles sont prêtes à offrir une aide économique
substantielles aussitôt que le cessez-le-feu le permettra.
Carte du Darfour
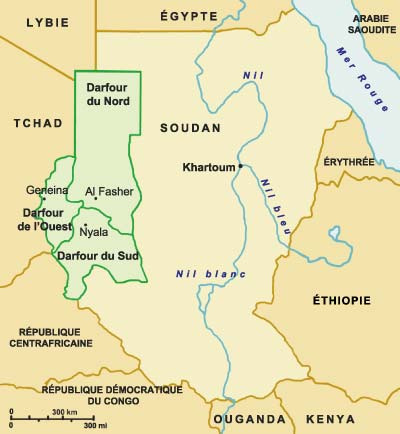
Carte des
villages détruits au Darfour au 2 août 2004

Sources :
http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur_conflict
Menu |